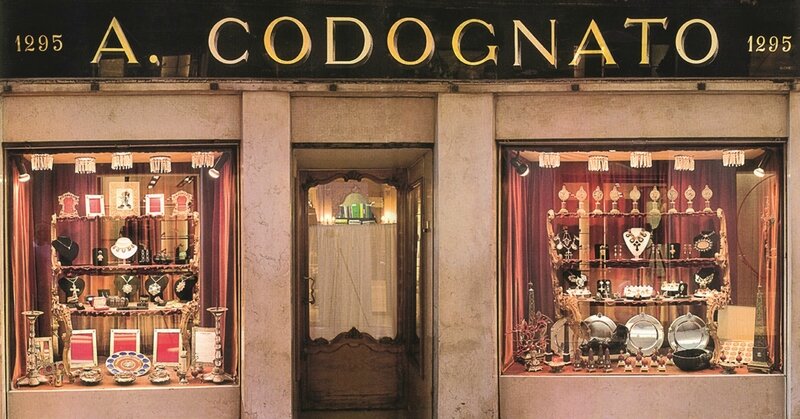Je viens de terminer la lecture de l’article de Geoffroy Patriarche et de Marie Dufrasne intitulé « penser les pratiques numériques : Le réseau comme catégorie conceptuelle pour la recherche sur les audiences et les publics »
Patriarche, Geoffroy, and Marie Dufrasne. “Penser la diversité des pratiques médiatiques : Le réseau comme catégorie conceptuelle pour la recherche sur les audiences et les publics.” Réseaux 187 (2014): 195–232. Web. 1 Apr. 2015.
Ma notice Zotero : penser la diversité des pratiques médiatiques
Ma lecture de cet article
La question d’une redéfinition des cadres d’analyse des pratiques médiatiques se posent à partir du moment où les notions d’audience et son corollaire de communauté et celle de public ne semblent plus suffisante pour définir les pratiques médiatiques. Le terme d’usager un temps choisi pour sa neutralité même s’il est intéressant pour couvrir les pratiques de réception des médias et de production par ces nouveaux acteurs reste trop centré sur le rapport à la technologie et ne prend pas suffisamment en compte les aspects créatifs et de rapprochement proam.
Ce besoin de redéfinition est bien sûr la conséquence de l’irruption technologique des réseaux et particulièrement d’internet, mais la question est antérieure à partir du moment où il s’agit de prendre en compte ce que l’usager fait des médias au delà de la simple consommation passive. En ce sens, l’apparition de la télécommande et du zapping est peut être déjà un acte qui remet en cause la simple audience (avis perso).
A approfondir les notions de communauté imaginée et de communauté interprétative
Pour engager ce travail de définition, il convient de choisir une stratégie conceptuelle. Les auteurs vont alors présenter les différentes stratégies qu’ils ont repérées dans la littérature professionnelle :
-la substitution d’un concept par un autre avec l’emploi du terme d’usager (déjà abordé plus haut)
– l’hybridation avec les figures du telespect-acteur, du prosumer, du webuser qui ne considère que l’individu dans sa pratique au détriment du rôle toujours central du média et qui considère les individus comme égaux en production,c e qui est faux, chacun assumant des rôles différents selon ses besoins, désirs, envies…
– la variation du concept qui est une définition par point de vue sur la chaîne de production et de communication (avis perso et très rapide). A noter les notions d’audience simple, audience de masse et d’audience diffuse qui serait une nouvelle catégorisation n’éliminant pas les précédentes mais la subsumant (emploi du terme nouveau pour moi – pas sûr qu’il soit adéquat ici). Cette audience diffuse est la conséquence d’un brouillage de la frontière entre public et privé d’une part et d’un rapprochement (raccourcissement de la distance?) entre producteurs et consommateurs. D’autres préfèrent le terme d’audience étendue à celui d’audience diffuse.
– L’articulation postule que les différents concepts sont à repenser avec d’autres nouveaux concepts. Il n’y a donc pas, comme dans la variation plusieurs types de situation mais plusieurs types de pratiques. C’est dans ce cadre, en lien avec la sociologie interprétative, qu’est défini le mode d’action selon deux dimensions : actancielle et structurelle. Simultanément/successivement, les usagers peuvent être audience quand ils reçoivent le média, producteur, communauté quand le contenu renforce les liens ou public quand il y a un impact social. L’audience, le producteur, la communauté et le public agissent tantôt comme des modes d’action, lorsqu’ils donnent forme à ces activités, tantôt comme des projets, lorsqu’ils fournissent le sens social de cet ensemble structuré d’activités articulées les unes aux autres. Ce qui devient central, c’est alors la notion de pratiques qui transforme les catégories antérieures d’audience, de communauté, de public et qui permet alors de questionner les tensions entre chaque pratiques.
– désolidariser les critères de définition. Alors que la stratégie précédente s’appuyait sur l’existant conceptuel qu’elle retransforme, celle ci part du tronçonnage des catégories existantes en concepts élémentaires afin d’avoir un outillage plus fin pour penser le changement.
Les auteurs de cet article font alors le choix de la stratégie d’articulation en examinant le potentiel heuristique et analytique de la catégorie du réseau.
Notre démarche s’appuie également sur une désolidarisation des critères de définition du réseau. Six dimensions du réseau en tant que mode d’action avec/par les médias seront explorées ici : (1) la construction de relations, (2) la co-création de contenus ou de technologies, (3) le partage, la circulation, (4) la dédifférenciation des espaces, (5) l’individualisation du temps et (6) le court-circuitage des intermédiaires.
Ils examinent ensuite les six dimensions qu’ils viennent de proposer :
– Construire des relations. Ce qui est au centre avec cette notion de réseau c’est le primat accordé à la relation et non plus simplement la construction de sens collectif autour d’un contenu média comme dans l’audience/communauté ou la production d’une discours dans la sphère publique citoyenne. Dans le mode d’action réseau, les ressources sont mobilisées pour construire, entretenir, enrichir du lien. Les auteurs distinguent ici la notion de communauté vue comme le sentiment d’appartenance à un territoire géographique ou communicationnel fondé sur des valeurs, des pratiques ou des intérêts communs. La notion de réseau est plutôt à observer comme une mise en relation qui peut être stratégique, affinitaire, opérationnelle ou conjoncturelle. Le réseau est d’abord de l’ordre du flux et s’oppose à la communauté qui serait de l’ordre du territoire. Mais les deux notions peuvent se superposer et s’interpénétrer.
– Co-créer des contenus ou des technologies. Il s’agit ici de voir la multiplication des rôles que peuvent tenir les usagers, de la simple consommation (audience) à la production de contenu. Ces pratiques sont à replacer dans le contexte des groupes sociaux pour lesquels la production fait sens. la co-création en réseau fait s’interpénétrer des pratiques d’amateurs et de professionnels, sans parler des nombreuses nuances entre ces deux extrêmes et des pratiques dont le statut est difficilement identifiable.
– Partager et faire circuler l’information. Cette notion de partage introduit un intermédiaire dans le couple production/réception, celui qui enrichit, ou non le contenu et qui le redistribue (pratiques de curation). Les contenus qui circulent sont de plusieurs ordre : information (media, knowledge) mais aussi conseils, contacts, traces (knowledge, identité), prescriptions de tout ordre… Le partage d’informations répond à trois motivations : « affective » (témoigner son attention, faire sourire), « conative » (renforcer des valeurs ou des intérêts partagés) et « promotionnelle » (se faire valoir ou promouvoir un événement).
– Dédifférencier l’espace. Un réseau fonctionne en flux ce qui permet aux usagers de dépasser les frontières communautaires dans leur quête de ressources. La notion de flux permet de dépasser les contraintes de territoire adossé à son contado (souvenir de l’histoire des cités italiennes). En ce sens une communauté permet de gérer des ressources qui sont prioritairement ou exclusivement accessibles à ses membres, alors qu’un réseau permet d’y accéder comme un grand sac à malice ou un puits sans fond. Le réseau, quelque part est donc une réponse à l’essoufflement des ressources et s’oppose à une vision gestionnaire en bon père de famille (avis perso).
– Individualiser le temps. Nous passons d’une gestion du temps qui est maitrisé par le producteur traditionnel qui propose des ressources en continu mais sans contrôle par le récepteur et qui scande le temps par le recours à une périodicité sans archives, à une gestion du temps qui est maitrisé par le récepteur qui choisit les ressources qu’il consomme selon son quotidien en dehors des routines. A voir maintenant comment ses différents temps se conjuguent ? Manque ici, il me semble ce qui est le « real time » et le rapport à l’évènement (avis perso).
– Court-circuiter les intermédiaires.
En conclusion après avoir rappelé le travail de conceptualisation opéré dans l’article, les auteurs montre l’importance de l’hyper-connection au mode d’action en réseau comme étant deux facteurs de reproduction sociale (capital, culturel, capital social, capital symbolique).
En termes d’éducation aux médias, l’objectif n’est donc pas que tout le monde
maîtrise les compétences avancées du réseau, mais puisse mobiliser une
variété de modes d’action adaptés à différents projets, à différentes situations
et à différents impératifs.
En ouverture, les auteurs pointent l’obligation de passer par ce schéma définitoire des modes d’actions avant d’envisager la dimension structurelle des plateformes d’hébergement de ressources et de mise en relation et les négociations entre ces instances et les usagers.
Resterai à couvrir la dimension politique des injonctions liés à ce nouveau mode : obligation de communiquer, de produire, de partager pour qui ? pour quoi ?
A lire en complément // issue de la bibliographie
BIDART C. (2008), « Étudier les réseaux. Apports et perspectives pour les sciences
sociales », in Informations sociales, n° 147, pp. 34-45.
CASTELLS M. (1998), La société en réseaux. L’ère de l’information 1, Paris, Fayard.
DEVILLARD V., DOLEZ C., RIEFFEL R. (2013), « La consommation de l’information entre engagement professionnel et implication civique », in Jouët J., Rieffel
R. (dir.), S’informer à l’ère numérique, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
pp. 85-116.
Proulx S., Poissant L., Senecal M. (dir.), Communautés virtuelles. Penser et agir en réseau, Québec, Presses de l’Université de Laval, p.107-129.
JOUËT J. (2000), « Retour critique sur la sociologie des usages », in Réseaux, vol. 18,
n° 100, pp. 487-521.
Jouët J., Rieffel R. (dir.), S’informer à l’ère numérique, Rennes, Presses universitaires de Rennes
LIVINGSTONE S. (2004), « Du rapport entre audiences et publics », in Réseaux,
n° 126, pp. 17-55.
En voici le résumé copié collé de cairn
Les transformations socio-techniques qui travaillent les pratiques d’usage, de réception et de participation médiatiques remettent en question les catégories fondamentales de la recherche sur les audiences et les publics – « l’audience » et « le public », bien évidemment, mais aussi « la communauté ». Dans un premier temps, l’article présente et discute quelques grandes stratégies conceptuelles autour de l’audience et du public visant à donner sens à la transformation des pratiques médiatiques. Ces stratégies sont la substitution, l’hybridation, la variation, l’articulation et la désolidarisation des critères de définition. Dans un second temps, l’article évalue le potentiel heuristique et analytique de la catégorie du réseau lorsqu’il s’agit de questionner et d’étudier la diversité et l’articulation des pratiques médiatiques. Sont mis en avant six critères de définition du réseau qui permettent de spécifier certains modes d’action avec/par les médias, mieux que ne le font les notions d’audience, de public et de communauté : (1) la construction des relations, (2) la co-création de contenus ou de technologies, (3) le partage, la circulation, (4) la dédifférenciation des espaces, (5) l’individualisation du temps et (6) le court-circuitage des intermédiaires. En guise de conclusion, l’article évoque quelques problèmes que pose la notion de réseau et suggère des pistes d’approfondissement.
Cet article Lecture de « Penser la diversité des pratiques numériques » est apparu en premier sur relation, transformation, partage.